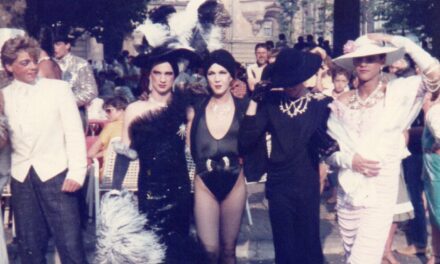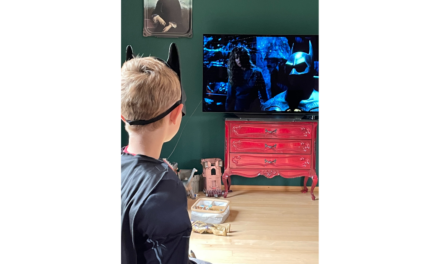L’argent. C’est la réponse donnée par les personnes contactées pour écrire cet article lorsqu’on leur a demandé : “Qu’est-ce qui vous aurait le plus aidé pour vous installer pendant vos premières années au Luxembourg ?”. Plus d’argent aurait pu aider les personnes interrogées dans leurs démarches pour louer un appartement, quitter les refuges pour réfugié.e.s, et échapper aux insultes homophobes ainsi qu’à l’exclusion sociale. “Pour beaucoup de personnes LGBTIQ+ qui cherchent à échapper aux persécutions et à l’hostilité dans leurs pays de naissance, la promesse de sécurité émise par le système d’asile luxembourgeois déçoit bien vite leurs attentes.” Pour écrire cet article, nous avons interrogé quatre personnes ayant fait une demande d’asile au Luxembourg. Deux d’entre elles sont arrivées en 2015, lorsque la crise des réfugié.e.s syrien.ne.s a atteint son sommet. Les deux autres cas sont plus récents. Deux de nos protagonistes ont souhaité rester anonymes, tandis que les deux autres ont parlé à visage découvert. Toustes ont fait évaluer leur droit d’asile, et toustes ont traversé des périodes sombres durant ce processus.
Je suis trop féminine pour être lesbienne
Le taux de personnes queer qui cherchent asile au Luxembourg est indéterminé. Le ministère de l’Intérieur et son département dédié à l’immigration (qui est donc en charge des demandes d’asile) ne gardent pas de traces des raisons qui nécessitent la protection internationale du Grand-Duché. Le ministère publie un rapport mensuel détaillant les chiffres des demandes d’asile, combien sont acceptées, combien sont rejetées, et quels sont les pays d’origine des demandeur.euse.s. Que ces personnes aient fui la guerre, soient des réfugié.e.s politiques, ou aient fui les menaces et persécutions liées au genre ou à l’orientation sexuelle, tout cela ne figure pas dans les statistiques. Par conséquent, les informations sur le taux d’acceptation des personnes LGBTIQ+ n’existent pas.
Ce que nous savons en revanche, c’est le motif de refus pour les personnes queers. L’organisation pour les droits des réfugié.es Passerell Asbl rencontre deux motifs de refus dans leur travail. La directrice Marion Dubois explique : “Les autorités ont tendance à affirmer que les persécutions à l’encontre des personnes LGBTIQ+ ne sont pas si graves dans leurs pays, et qu’elles ne rentrent pas dans les prérequis de la Convention de Genève.” C’est par exemple le cas lorsqu’un pays adopte une loi décriminalisant l’homosexualité, ou que des dispositifs sont mis en place par la société civile ou la police afin de protéger les droits des personnes LGBTIQ+. “Ou alors, ils pensent que la personne n’est pas réellement ce qu’elle prétend être, qu’elle n’est pas réellement homosexuelle par exemple.”
C’est ce qui est arrivé à Betty, notre première protagoniste. Elle a des cheveux bouclés rose métallique, deux piercings au nez, de longs cils et un maquillage très discret sublimé par un mascara et un rouge à lèvres rose.
Ils disent que je suis trop féminine pour être lesbienne. Ils ne me croient pas. C’est tellement insultant. Pendant notre entretien, ils m’ont parlé de ma première expérience, de mon premier amour. Mais ils ont dit que mon récit n’avait pas l’air assez romantique. Pourquoi le serait-il ? Ça fait plus de dix ans que je suis passée à autre chose. Ils m’ont demandé si je suis en couple. Je sortais avec cette fille à l’époque, je leur ai même montré une photo de nous en train de nous embrasser dans la rue, quelque chose qui m’est interdit de faire dans mon pays. Ils ont répondu que n’importe qui pouvait prendre ce genre de photo, et que ça ne montrait pas réellement qu’il y avait de l’amour. Comment est-ce que je prouve de l’amour ? Je leur ai montré une photo que j’ai prise à la Pride avec des ami.es. Je leur ai même demandé s’ils voulaient voir des photos ou des vidéos intimes de moi avec une autre femme. Je peux vous les montrer, leur ai-je dit. Ils ont répondu que non, je n’avais pas à les montrer. Donc j’étais en mode : qu’est-ce que vous voulez que je vous montre ? C’est tellement fatigant.
Betty est arrivée au Luxembourg en 2022. Avant ça, elle a vécu aux Pays-Bas pendant des années. Elle y est arrivée en 2011 depuis l’Éthiopie par le biais d’un trafic d’êtres humains. Elle a volontiers quitté son pays, avec la promesse de recevoir une éducation et de pouvoir travailler; elle voulait devenir journaliste. Betty ne veut pas nous raconter ses premières années aux Pays-Bas, ou ce qu’elle a dû faire pour rembourser sa dette auprès des trafiquants. “Ça me ramène vers des moments sombres,” dit-elle. Mais elle y est tout de même arrivée. Durant la période où elle était à la structure d’hébergement d’urgence Kirchberg (SHUK), elle a tenté de mettre fin à ses jours. “Il n’y avait que deux femmes et une famille dans cet immense endroit. C’était tellement vide. J’étais tellement au bout du rouleau, et je venais de recevoir le rejet de ma demande,” dit-elle. Elle fut ensuite hospitalisée pour deux mois, puis transférée dans un autre centre d’accueil.
La direction de l’immigration était méfiante lorsque Betty est arrivée au Luxembourg. Elle avait déjà fait une demande d’asile aux Pays-Bas quelques années plus tôt. Elle avait 19 ans à son arrivée en Europe. Après quelque temps, elle a réussi à engager des poursuites contre ses trafiquants et à obtenir la protection de la police durant la procédure, mais l’enquête n’a pas abouti. Lorsque les charges ont été abandonnées, Betty a perdu sa protection. Elle a fait une demande d’asile liée à son orientation sexuelle, qui a été rejetée. Elle vit sans papiers depuis lors, travaillant dans des restaurants néerlandais sans être déclarée. Sa demande a également été rejetée au Luxembourg. Elle est désormais en attente de sa demande d’appel au tribunal.
Je suis venue ici car je voulais obtenir des papiers. Je n’avais aucun espoir aux Pays-Bas. J’ai tenté d’obtenir l’asile ici, et ça n’a pas marché non plus. Mais je ne pense pas que j’ai été jugée équitablement aux Pays-Bas.
Je ne peux pas retourner chez moi. Je ne peux pas être moi-même ici. Je ne pourrai jamais vivre ma vie comme je le voudrais. Je vais toujours devoir faire profil bas et faire semblant. Lorsque j’ai fait ma première fois et que ma famille l’a su, ils m’ont emmenée à l’église pour me donner de l’eau bénite, comme si j’étais malade et que je devais guérir. Après ça, j’ai fait comme si tout allait bien. J’ai essayé de sortir avec un homme aux Pays-Bas, de construire cette vie de famille traditionnelle. Je pensais que c’était quelque chose que je pouvais réparer.
Franck Greff a été l’avocat de beaucoup de demandeureuses d’asile queer pour les accompagner dans leurs procédures. Il les a aidé.e.s à rassembler les preuves dont les officiers de l’immigration avaient besoin et à les préparer pour les entretiens. “Les demandeureuses pour la protection internationale doivent avoir un récit aussi complet et substantiel que possible,” a-t-il déclaré. “Le ministère peut comprendre qu’il est compliqué d’obtenir des preuves dans certains pays, mais si ça fait quelques mois que vous êtes au Luxembourg, vous pouvez prouver que vous avez été en contact avec la communauté, que vous avez participé à des Prides ou à tout autre événement organisé par la communauté. Même si une personne ne souhaite pas afficher son orientation sexuelle sur les réseaux sociaux, il y a mille et une autre façon d’apporter des preuves. Il leur est tout à fait possible de passer au Rainbow Center sans que personne ne les voie.”
Pour Franck Greff, le système est juste. Selon lui, si les gens sont prêts à fournir toutes les informations nécessaires pour assurer de la validité de leur cas, ils ont de très grandes chances d’obtenir un statut de réfugié.e. Il est convaincu que le ministère et lui ont le même but : protéger ceux qui en ont besoin. “Si une personne est en danger dans son pays d’origine à cause de son homosexualité, cette personne doit être protégée, il n’y a pas de débat là-dessus. Mais il est primordial d’être sûr, ou du moins à peu près convaincu que cette personne est effectivement en danger dans son pays.” Pour le déterminer, les demandeureuses sont interrogé.es pendant des heures, voire des jours. Franck Greff se souvient du cas d’un homme gay venant du Bangladesh dont l’interrogatoire a duré six jours. Greff et Passerell pensent que c’est une bonne chose. Ça permet aux personnes de raconter pleinement leur histoire. La décision s’appuie ensuite sur une enquête minutieuse.
Dans le cas de Betty cependant, les preuves qu’elle a amenées n’ont pas semblé être suffisantes pour prouver qu’elle est bien ce qu’elle prétend être.
J’ai obtenu cette réponse positive grâce à tout ce soutien
Et même pour notre second protagoniste, il aurait dû être plus simple d’obtenir l’asile au Luxembourg. René était un militant LGBTIQ+ connu en Russie, son pays de naissance. C’est lui qui organisait la Marche des Fiertés de Moscou, et c’était un des porte-parole pour les droits LGBTIQ+ les plus actifs dans son pays, jusqu’à ce que les lois homophobes de 2013 interdisent toute expression d’identités queer en public et donnent un nouveau souffle aux violences homophobes, qui ont grimpé en flèche. À Moscou, René était persécuté par la police et attaqué par des personnes LGBTIQphobes dès qu’il mettait le pied dehors. Il n’a pas pu faire soigner son nez cassé à l’hôpital, de peur de se faire arrêter. Tous ses déboires sont très bien documentés. Son histoire s’est retrouvée dans une dizaine de journaux internationaux. Les preuves qui démontraient que sa vie en Russie était en danger étaient plus que tangibles. Mais malgré ça, il a senti que convaincre les autorités de l’immigration n’a pas été une mince affaire.
J’ai demandé l’asile politique durant l’année de la crise migratoire. Mon cas était complètement différent de ceux des Syrien.ne.s, donc je suppose qu’ils n’avaient pas la moindre idée de ce qu’ils devaient faire. C’était comme si j’étais le premier réfugié queer. Grâce à mon engagement activiste, j’ai reçu beaucoup de soutien de la part de la population, des médias, d’Amnesty International, de Rosa Lëtzebuerg et de Centre LGBTIQ+ CIGALE. J’ai donné des interviews pour Le Quotidien et Woxx, et je pense que j’ai obtenu mon statut grâce à ça. En 2015, on était trois gays originaires de Russie. Le premier a eu une réponse négative. Le second était un ami très proche. Il a attendu plus d’un an au foyer de Wiltz, et il s’est retrouvé complètement dévasté lorsque son ami a eu une réponse négative. Alors il a sauté d’un pont. Suicide. Donc, on était trois gays venant de Russie, et seulement un seul d’entre nous a obtenu une réponse positive, grâce à tout ce soutien, je pense.
L’affaire de l’ami de René, Sergueï Vladimirov, qui s’est ôté la vie, est apparue dans les médias à l’époque, mais cette couverture médiatique n’a pas eu de conséquences connues. Aujourd’hui, la situation est toujours difficile. La vie dans les abris est teintée par l’incertitude de celles et ceux qui attendent une réponse de la part des autorités, ce qui rend leur quarantaine encore plus compliquée à supporter. Cependant, pour les personnes LGBTIQ+ ouvertement queers qui font une demande d’asile, la situation est souvent pire. René a dû attendre 15 mois pour recevoir une réponse positive.
C’était infernal. D’abord, j’ai dû me rendre à Limpertsberg. C’était un foyer énorme, avec beaucoup de monde. J’ai commencé à sentir que j’étais en train de revivre la même merde qu’en Russie, la même discrimination, ma même haine, tous ces commentaires, toutes ces insultes. Il y avait un autre homme qui venait du Kosovo, gay lui aussi, et personne ne voulait s’asseoir près de nous dans la salle à manger, parce que c’est haram. J’ai donné quelques interviews, et les journaux avec ma tête en couverture étaient en libre accès dans la salle à manger. Tout le monde savait. C’était un espace très clos. Pour sortir et faire quelque chose, il fallait de l’argent. J’avais le document de voyage pour les réfugié.e.s, donc j’ai pu prendre les transports en commun gratuitement. J’ai donc traversé le pays, inspecté chaque château, chaque forêt, chaque lacs et chaque rivière, presque tous les villages. Je me suis rendu à des rencontres entre les locaux et les réfugié.e.s, mais il semblerait que je sois trop blanc pour être un réfugié. À cette époque, les gens voulaient montrer leur solidarité, et les médias diffusaient des images stéréotypées de réfugié.e.s. Alors les gens m’ont ignoré. Et après avoir dit que je suis gay, que je suis trans, je n’ai plus jamais été invité à ces événements.
Ensuite, j’ai été à un refuge à Schifflange. Je suis reconnaissant envers le gouvernement luxembourgeois, envers l’Office national de l’accueil (ONA) et envers la Croix Rouge pour m’avoir donné une chambre à part. Mais je devais partager les espaces communs, comme la cuisine, la salle de bains et les toilettes avec les autres réfugié.e.s, qui s’en sont pris à moi. Je n’ai jamais caché qui j’étais, je leur ai dit que je suis gay, queer, trans. Une fois, l’un d’entre eux s’est approché de moi et m’a dit : “Je m’en fous de quels mots tu utilises pour te désigner, si tu as un vagin, je vais te baiser.” Je venais tout juste d’échapper à la persécution par les autorités. J’ai été torturé des millions de fois en garde à vue. Donc je n’ai pas pensé une seule seconde à appeler la police, j’étais complètement bloqué. Je vivais cet enfer, tous les jours, toutes les nuits. Il y a des refuges queers à Berlin, à Amsterdam, dans les autres pays. C’est quoi le putain de problème avec ce pays ?
René a milité pour la création de refuges dédiés seulement aux personnes queers. L’Office national de l’accueil (l’ONA), qui s’occupe de la grande majorité des hébergements pour les réfugié.e.s, explique cependant : “Tous les hébergements de l’ONA sont des structures mixtes, sans considération pour le genre, l’âge ou les origines. Cette diversité permet aux gens de s’accoutumer à l’environnement multiculturel du Luxembourg. De plus, le respect mutuel et l’acceptation culturelle sont des valeurs partagées au sein des structures, et sont inclus dans les règles internes.” Des propos qui sont durs à avaler pour les personnes ayant eu une expérience similaire à celle de René.
Les travailleurs sociaux de l’ONA et de la Croix Rouge ont tous les deux annoncé que leurs employé.e.s ont reçu une formation spéciale donnée par le Centre LGBTIQ+ CIGALE pour mieux comprendre et mieux soutenir les personnes queers. Andre Soares de Andrade, responsable du service “Migrant.e.s et réfugié.e.s” de la Croix Rouge, nous dit : “Nous essayons de créer un lien de confiance avec tout le monde, et si c’est nécessaire, nous augmentons notre présence et nos interactions.” Mais malgré toutes les mesures mises en place, les réfugié.e.s ont encore des difficultés pour trouver le soutien nécessaire.
Ils vous mettent dans la même chambre que ceux que vous aviez fuis
Notre troisième protagoniste, Haval*, avait 18 ans et un lourd traumatisme lorsqu’il est arrivé au Luxembourg en 2020. C’était la deuxième fois qu’il fuyait son pays. Haval et sa famille kurde ont déjà dû quitter leur pays d’origine, la Syrie, des années auparavant. Il était âgé de onze ans lorsqu’ils arrivèrent dans la ville kurde d’Erbil, en Irak. Il y a vécu aux côtés de sa famille pendant sept ans, avant de devoir tout quitter pour vivre une nouvelle vie au Luxembourg.
Ma famille a découvert que je suis gay lorsque je l’ai annoncé à une de mes sœurs. Elle était très ouverte d’esprit sur ce sujet, et n’a pas eu de mal à m’accepter. Alors elle l’a dit à tout le monde, car elle a pensé que tout le monde réagirait comme elle. Mais ça n’a pas été le cas. Mes autres sœurs ainsi que le reste de la famille étaient absolument contre. Ils ont fini par le dire à mes oncles, et tout le monde s’est retrouvé impliqué. Ils disaient que j’allais ruiner la réputation de la famille, qu’ils allaient devoir se débarrasser de moi. Ils voulaient me tuer.
Ma mère m’a aidé, elle a payé le passeur, et la décision de fuir a été prise en l’espace de quelques jours. Quand je suis arrivé à ce stade, j’étais très affecté par cette situation. Ta famille, que tu penses être un safe space, devient l’endroit le plus dangereux pour toi en l’espace d’une nuit. Puis, j’ai fui. Et je me disais, mais qui est-ce que je suis ? Je ne me reconnais pas en ces gens, plus maintenant. Mais j’étais aussi dans un pays étranger, au Luxembourg, et je ne me reconnaissais pas dans ce pays non plus. J’ai eu une grosse crise identitaire, parce que je ne savais plus à quoi j’appartenais. Je pense que les êtres humains ont le besoin de sentir qu’ils et elles sont membres d’une communauté ou d’un pays, on ne peut pas fonctionner si on n’a pas ce sentiment.
Je me suis retrouvé dans un état de dépression très avancé, et l’atmosphère du refuge, le fait d’être entouré par ces personnes qui ne m’acceptent pas, ça a empiré les choses. Ils vous mettent dans la même chambre que ceux que vous avez fuis. Lorsque j’allais dans la cuisine pour me faire à manger, personne ne me parlait. Mais j’entendais les murmures et les rires, je savais qu’ils riaient de moi. Je restais cloîtré dans ma chambre tout le temps, je ne parlais à personne.
J’ai eu quelques séances avec les psychologues du refuge. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas vraiment m’aider, qu’il fallait que je voie un psychiatre. Le psychiatre m’a écouté pendant 10 minutes et m’a prescrit des médicaments. Il ne m’a pas été très utile. Et il faut demander pour avoir un soutien psychologique, ils ne te demandent pas si tu en as besoin.
Passerell asbl critique cette procédure. Marion Dubois nous dit : “Nous demandons aux demandereuses d’asile d’être proactif.ve.s quand il s’agit de leur santé, physique ou mentale.” Des groupes militant pour les droits des réfugié.e.s ont demandé à ce qu’un mécanisme de détection de vulnérabilité préventif en coopération avec des médecins, psychiatres et psychologues soit mis en place par les autorités en charge de l’immigration, ainsi qu’une assistance sociale de la société civile assez compétente pour permettre l’accès à des soins médicaux et sociaux. L’ONA a déclaré que dès que les réfugié.e.s LGBTIQ+ sont dans leurs refuges, ils et elles sont donc sous leurs soins, “ils et elles sont considéré.e.s comme étant des personnes ‘vulnérables’ et bénéficient de soins additionnels et de soutien psychologique, surtout si ils ou elles sont victimes de violences. L’ONA travaille en collaboration étroite avec des ONGs comme Cigale.” Andre Soares de Andrade, travaillant à la Croix Rouge, ajoute : “Nous analysons et détectons systématiquement les vulnérabilités des nouveaux.elles arrivant.e.s en quête de protection internationale, ce qui nous permet d’estimer les besoins spécifiques des nouvelles personnes arrivant au sein de nos foyers.” Toutes ces mesures ont déçu les attentes de nos protagonistes.
Je me sens libre. J’ai un travail. J’ai tout ce qu’il me faut
Aujourd’hui, Haval va bien. Depuis qu’il a trouvé une famille d’accueil et qu’il a réussi à sortir du refuge, il est en meilleure santé. Il a commencé des études à l’université, et son cercle d’ami.e.s n’est composé que de personnes queer ou queer-friendly. Il a trouvé un psychologue qui l’aide. D’autres n’ont pas eu autant de chance. Alors que Betty est toujours en attente d’une réponse pour son statut de réfugiée, René s’est senti piégé dans ce système. Un environnement offrant plus de soutien aurait pu l’aider. Yasser* est la seule personne parmi nos quatre protagonistes qui n’a pas eu ce genre d’expérience.
Yasser est arrivé de Syrie en 2015. Il avait 25 ans lorsqu’il a fui son pays aux côtés de millions d’autres réfugié.e.s. Il vivait dans la peur des poursuites judiciaires à cause de son homosexualité, et sa famille n’acceptait pas non plus sa sexualité. Il a donc dû se protéger. Yasser a passé vingt mois en refuge avant d’obtenir le droit d’asile. À ce moment, les requêtes concernant les réfugié.e.s de la guerre en Syrie étaient généralement acceptées, peu importe le genre ou l’orientation sexuelle. Yasser avait un petit copain au Luxembourg qui l’a soutenu pendant la durée des démarches. Il n’affichait pas ouvertement son orientation sexuelle, il n’a donc pas été harcelé. Son seul problème était l’argent : “Je n’avais que 25 euros par mois,” dit-il. “Mais comme je ne fume pas, ça allait”.
J’ai été interrogé deux fois par le ministère. Ils étaient gentils. Ils m’ont seulement posé des questions générales, comme : Pourquoi es-tu venu ici ? Pourquoi avoir choisi le Luxembourg ? Ils m’ont recommandé certains groupes où je pouvais aller si je suis gay. Évidemment, j’avais peur à cette époque, je ne savais pas à quoi mon futur allait ressembler. Mon petit copain m’a aidé. Il m’invitait parfois chez lui, on cuisinait tous les deux et je restais parfois dormir. Et le refuge était loin d’être bondé. C’était comme un hôtel avec dix personnes à l’intérieur, deux personnes par chambre. J’ai été transféré ici, dans le nord du Luxembourg, directement après mon arrivée. Tout s’est bien passé pour moi. C’était peut-être différent pour d’autres personnes, mais en ce qui me concerne, tout était parfait. J’avais tout ce dont j’avais besoin.
Son conseil à toutes les autres personnes qui se retrouveraient dans une situation similaire est :
Soyez fort.e, soyez patient.e. Je ne pense pas que les choses changeront en Syrie. Vous ne pouvez pas changer la religion. Les gens devraient chercher la liberté, car la liberté est possible. Choisissez où vous voulez vivre, et allez-y. Ici, vous pouvez vous sentir libre. Je me sens libre. J’ai un travail. J’ai tout ce qu’il me faut.
*Cette personne a souhaité rester anonyme. L’équipe éditoriale lui a donc donné un faux nom pour cet article.
Article traduit de l’Anglais par Félix Moliner Montmartin