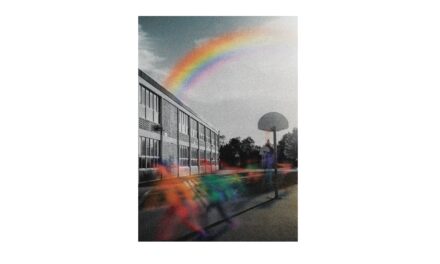Depuis les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky sur la prise de décision et les biais cognitifs, nous savons que l’idée d’un individu rationnel, dans l’économie et la psychologie, est remise en question. Contrairement à la théorie classique de l’utilité attendue, Kahneman et Tversky montrent que les individus ne prennent pas toujours des décisions rationnelles.
Ainsi, certains de nos comportements et de nos prises de décision peuvent paraître paradoxaux. N’est-il pas fréquent de croiser des personnes issues des classes populaires voter pour un programme politique aux antipodes de leurs intérêts économiques et psychologiques ? Ou encore des personnes racisées rejoindre des espaces ultra nationalistes et xénophobes ? Ou des personnes LGBTIQ+ adhérer à des dynamiques d’exclusion transphobe, validiste ou raciste ? Ainsi, cet article vise à explorer une partie des mécanismes sous-jacents à ces formes d’irrationalité observables chez les membres de groupes stigmatisés.
Comprendre la stigmatisation : un processus de disqualification sociale
Le sociologue Erving Goffman définit la stigmatisation comme un processus par lequel un individu est discrédité socialement en raison d’une caractéristique perçue comme déviante ou inférieure (orientation sexuelle, genre, origine, classe sociale, handicap, etc.). Cette marque sociale entraîne une disqualification de la personne dans les interactions sociales et une image souvent négative.
Dans le cadre des minorités LGBTQIA+, des personnes racisées ou migrantes, la stigmatisation se manifeste sous plusieurs formes :
- Le rejet et l’exclusion sociale (famille, travail, institutions).
- Les discriminations structurelles (accès à la santé, logement, droits).
- La violence physique et symbolique (insultes, agressions, invisibilisation).
Selon Abdelmalek Sayad, la stigmatisation des immigré·e·s et de leurs descendant·e·s produit une double absence : iels sont à la fois exclu·e·s du pays d’origine et marginalisé·e·s dans la société d’accueil. Ce phénomène est similaire à ce que vivent de nombreuses personnes LGBTQIA+, prises entre le rejet familial ou culturel et la discrimination sociétale.
L’impact psychologique de la stigmatisation : un traumatisme invisible
L’exposition prolongée à la stigmatisation entraîne des conséquences psychologiques.
Stress minoritaire et hypervigilance :
- Les personnes stigmatisées vivent dans des états répétés d’anxiété dus à la peur du rejet ou de la discrimination (Meyer, 2003).
- Cela se traduit par une suradaptation : moduler son comportement, sa voix, ses expressions de genre pour éviter la violence ou le rejet. Exemple: certaines personnes LGBTQIA+ adoptent un comportement « discret » dans l’espace public pour éviter les agressions.
Dépression et isolement :
- De nombreuses études montrent que la stigmatisation accroît les risques de dépression, d’anxiété et de troubles de l’estime de soi.
- Abdelmalek Sayad souligne que les individus en situation de domination intériorisent souvent leur condition comme une fatalité, renforçant leur isolement et leur souffrance.
Quand le stigmate devient une prison intérieure
L’intériorisation du stigmate repose sur un processus d’aliénation identitaire : l’individu absorbe les jugements portés sur lui et les transforme en un sentiment de honte et d’infériorité. Goffman a analysé la manière dont le stigmate devient un « désavantage moral » intériorisé par les individus stigmatisés.
Ali Shariati, dans sa critique de l’occidentalisation, met en lumière un phénomène selon lequel les peuples dominés finissent par intérioriser une vision dévalorisante de leur propre culture et adoptent les normes imposées par l’oppresseur. Ce processus d’aliénation culturelle peut être rapproché de certaines dynamiques au sein des groupes minoritaires, où des individus tendent à reproduire les hiérarchies et les discriminations dominantes afin de mieux s’intégrer ou de se distinguer des membres les plus marginalisés de leur propre communauté. Un exemple significatif de ce mécanisme se retrouve dans la manière dont certains hommes cisgenres gays, se conformant aux standards de la masculinité normative, expriment du mépris ou exercent une forme de discrimination envers les hommes cisgenres gays plus efféminés. Ce phénomène est similaire au rejet des identités minoritaires par des membres eux-mêmes de ces communautés. Exemple : Certains membres de la communauté LGBTQIA+ adoptent des postures de rejet des identités non-binaires ou transgenres pour mieux s’intégrer dans la norme hétéro-cispatriarcale.
Intériorisation de la honte et du stigmate.
- La personne stigmatisée adopte progressivement le regard négatif posé sur elle par la société.
- Ce processus peut conduire à un rejet de soi, une haine intériorisée (homophobie ou racisme internalisé) et une quête de « normalité » à travers la conformité.
- Ali Shariati parle d’aliénation culturelle, où les opprimé·e·s intériorisent les valeurs et normes du dominant au point de se désolidariser de leur propre groupe.
Une expérience emblématique de psychologie sociale menée par Kenneth et Mamie Clark dans les années 1940 explore les effets de l’intériorisation du stigmate au travers de la ségrégation raciale sur l’estime de soi des enfants afro-américains.
Déroulement de l’expérience.
Les chercheurs ont présenté deux poupées identiques, à l’exception de leur couleur :
- Une poupée blanche (peau claire, cheveux blonds).
- Une poupée noire (peau foncée, cheveux noirs).
Ils ont demandé à des enfants afro-américains âgés de 3 à 7 ans de choisir la poupée qu’ils préféraient et d’associer des qualités aux poupées (gentille, méchante, belle, laide, etc.).
Résultats principaux :
- Une majorité des enfants afro-américains préféraient la poupée blanche, et lui attribuaient des qualités positives (gentillesse, beauté).
- À l’inverse, ils associaient des traits négatifs à la poupée noire (méchanceté, laideur).
- Lorsqu’on leur demandait « Quelle poupée te ressemble ? « , beaucoup hésitent , certains montraient la poupée blanche avant de corriger.
Interprétation et impact :
L’étude démontre que les enfants noirs ont intériorisé le racisme et les normes de la société ségrégationniste, ce qui affecte leur estime de soi. Ces résultats ont été utilisés comme preuve psychologique des dommages causés par la ségrégation raciale lors de l’affaire Brown v. Board of Education (1954), qui a conduit à l’interdiction de la ségrégation scolaire aux États-Unis.
Liens avec l’intériorisation du stigmate.
L’expérience de Clark & Clark illustre le phénomène où une minorité intériorise des normes dominantes qui la dévalorisent. Ce mécanisme est similaire aux processus d’homophobie internalisée, de transphobie intériorisée, ou à l’aliénation culturelle décrite par Ali Shariati et Abdelmalek Sayad.
Ce type d’expérimentation a inspiré d’autres recherches sur les effets de la discrimination systémique sur l’identité et la psychologie des groupes minoritaires.
Syndrome de l’imposteur et besoin de validation.
- La stigmatisation pousse parfois à une quête de reconnaissance excessive par le groupe dominant.
- Exemple : un individu issu d’une minorité peut surinvestir sa carrière, son image sociale ou son respect des normes pour être accepté.
- Ali Shariati parle de « l’homme occidentalisé » (gharbzadegi), qui adopte les codes du dominant pour prouver sa valeur, au prix de son identité profonde.
Le Queen Bee Effect : une dynamique d’aliénation ?
Le « Queen Bee Effect », selon Klea Faniko, décrit le comportement de certaines femmes dans des environnements professionnels dominés par les hommes. Ces femmes, en quête de reconnaissance et d’acceptation dans un système patriarcal, peuvent adopter des attitudes ou des pratiques qui reproduisent ou renforcent les inégalités de genre, au lieu de les contester. Elles s’alignent sur les normes masculines, voire se montrent critiques envers les femmes subordonnées, afin de maintenir leur position privilégiée dans un système qui reste globalement discriminatoire. Ce phénomène reflète une forme d’aliénation structurelle, où l’individu, pour se conformer au pouvoir dominant, contribue paradoxalement à sa propre marginalisation collective.
Bourdieu décrit la violence symbolique comme un mécanisme où les dominés incorporent les structures de pouvoir et les reproduisent. Klea Faniko, en étudiant le « Queen Bee Effect », montre que certaines minorités adoptent des attitudes excluantes pour se rapprocher du groupe dominant.
Ce phénomène reflète une forme d’aliénation structurelle, où l’individu, pour se conformer au pouvoir dominant, contribue paradoxalement à sa propre marginalisation collective.
Autre exemple : l’homonationalisme (Puar) illustre comment certaines personnes LGBTQIA+ se positionnent en défenseurs de l’ordre national en excluant les migrants ou en s’alignant sur des discours islamophobes. L’instrumentalisation des droits LGBTQ+ par des États occidentaux pour justifier des politiques nationalistes, sécuritaires ou racistes, notamment envers les populations musulmanes et immigrées. Sous cet angle, l’acceptation des droits LGBTQ+ devient un marqueur de supériorité civilisationnelle, opposant un « nous » progressiste et tolérant à un « eux » supposément homophobe et arriéré. Cette mécanique est semblable aux tensions internes dans les mouvements minoritaires : lesbiennes cisgenres contre lesbiennes trans, queers blancs vs queer racisés, etc. Ces divisions internes fragilisent la lutte collective et profitent aux structures dominantes.
Occidentalisation chez Shariati : une aliénation culturelle
Ali Shariati identifie l’occidentalisation comme une dynamique dans laquelle les élites des sociétés colonisées ou postcoloniales adoptent les valeurs, les normes et les comportements des puissances occidentales, souvent au détriment de leur propre culture et identité. Ces élites, fascinées par l’Occident, tentent de se conformer à ses standards (modernité, modes de vie, institutions), tout en dévalorisant leurs propres racines culturelles. Ce processus engendre une double aliénation : d’une part, les élites s’éloignent de leur propre communauté et, d’autre part, elles restent marginalisées dans le système occidental qui ne les considère jamais comme pleinement égales. Les élites jouent alors un rôle paradoxal : bien qu’elles aspirent à la modernité, elles participent à la reproduction des schémas de domination et d’oppression.
La quête d'acceptation dans un système dominant
Dans l’ensemble de ces théories, on observe une recherche de validation par une entité dominante :
- Queen Bee Effect : Les femmes dans un environnement patriarcal adoptent les comportements valorisés par les hommes pour gravir les échelons.
- Occidentalisation : Les élites colonisées ou postcoloniales cherchent à s’intégrer dans les structures imposées par l’Occident.
- Homonationalisme : Certains individus LGBTIQ+ adoptent les valeurs et discours de l’homonationalisme, même lorsqu’ils renforcent des logiques oppressives. Cela peut se traduire par une assimilation à la norme nationale, un rejet des identités marginalisées, ou encore l’alignement sur des discours sécuritaires.
Dans ce type de contexte, l’individu ou le groupe aliéné intériorise les normes du pouvoir dominant et se conforme à ses attentes, même si cela implique un renoncement à son identité ou à sa solidarité avec son groupe d’origine.
Le rôle du discours dominant dans l’aliénation
Shariati et Faniko mettent en lumière comment le discours dominant façonne les comportements :
- Shariati montre que les normes et les idéaux de l’Occident colonisateur sont diffusés par des institutions, des médias et des systèmes éducatifs, incitant les élites des pays colonisés à les adopter.
- Faniko observe que les normes masculines dominantes dans les environnements professionnels façonnent les comportements des femmes qui s’alignent sur ces standards pour réussir.
Le système dominant agit comme une force d’intériorisation des normes, rendant les aliénés complices malgré eux de leur propre marginalisation.
Les stratégies d’adaptation et de survie
L’aliénation ne se traduit pas toujours par une honte passive, mais parfois par des stratégies actives d’adaptation. En psychologie sociale, on parle de « passing », soit la tentative de se conformer aux normes dominantes pour éviter la discrimination.
Dans le cadre de l’immigration, Abdelmalek Sayad analyse comment les immigrés intègrent la hiérarchie sociale imposée et adoptent un comportement visant à se distinguer des nouveaux arrivants, perpétuant ainsi des dynamiques de rejet interne. Ce même mécanisme est observable dans les communautés LGBTQIA+ où certaines personnes racisées ou issues de classes populaires peuvent être marginalisées par des cercles plus favorisés.
L’aliénation ne se traduit pas toujours par une honte passive, mais parfois par des stratégies actives d’adaptation. En psychologie sociale, on parle de « passing », soit la tentative de se conformer aux normes dominantes pour éviter la discrimination.
Se réapproprier son identité et sortir du cercle vicieux
La réappropriation de ses identités ne peut se faire sans prise de conscience de ses propres mécanismes d’oppression intériorisés. La reconnaissance des structures de pouvoir et leur déconstruction passent par une éducation critique (Paulo Freire). Sayad montre l’importance de reconstruire des solidarités en dehors du cadre imposé par la société dominante et de revaloriser la solidarité intra-communautaire. Des initiatives telles que la ball culture, le militantisme intersectionnel ou la revalorisation des identités marginalisées permettent de créer des espaces de résistance et de répit.
Retrouver une puissance collective
L’intériorisation du stigmate est un outil puissant de domination, mais elle n’est pas une fatalité. À travers une prise de conscience critique et des actions de solidarité, il est possible de s’extraire de cette aliénation et de lutter contre les logiques oppressives. Comme le disait Ali Shariati : « Le pire esclavage est celui qui fait aimer ses chaînes. » L’enjeu est donc de briser ces chaînes pour construire des communautés plus solidaires et affranchies des normes imposées.
Pour aller plus loin :
– Jasbir Puar, Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times
– Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs
– Ali Shariati, L’Homme et l’Islam
– Abdelmalek Sayad, La Double Absence
– Klea Faniko, recherches sur le « Queen Bee Effect » (2021)
– Sara Ahmed, Queer Phenomenology (2006)